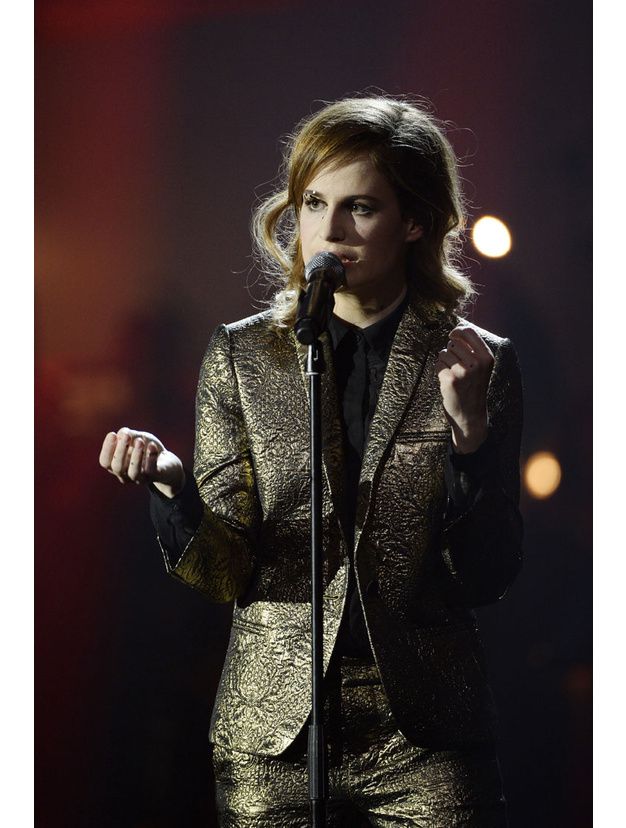Dans l'épopée de la marchandisation du monde, l'humain est notre far west actuel. L'un des champs de bataille de cette soumission est la procréation médicalement assistée, et ses perspectives multiples, révolutionnaires, à en donner le vertige.
Un basculement majeur, avec la procréation assistée, est celui, progressif mais tangible, qui voit - à mon sens fort dangereusement- le droit A l'enfant - à avoir un enfant, son enfant, et pourquoi pas l'enfant que je veux comme je veux- se substituer, en haut de la hiérarchie des normes, au droit DE l'enfant. L'enfant n'est pas là, il n'est pas né. Le droit du consommateur, immédiat, devient une référence centrale. C'est lui qui au niveau des institutions européennes par exemple, à travers la Direction de la Concurrence, supplante les autres considérations. A ce titre ne nous étonnons pas de voir les générations futures oubliées. Ce que nous avons fait de la planète en attestait déjà.
Cela n'émeut guère, excepté les chrétiens qui monopolisent ces débats dans une posture oppositionnelle, au nom de transcendances qui n'ont pas à s'imposer dans nos débats bioéthiques laïques, même si chacun est libre de penser ce qu'il veut. Nous sommes ici bas, c'est ici que ça se passe, et nous devons penser ces enjeux de manière séculière, et en tout cas aborder ces débats avec raison, et non au nom de tables de la loi dans le ciel. La question est : qu'est ce que ça fait aux humains ? Est-ce l'humanité à laquelle nous aspirons qui se dessine à travers nos législations ?
C'est l'essence de l'humanité qui est en cause, et finalement on s'en fiche un peu, tout le monde semble considérer que l'extension des possibilités technologiques, quand elle permet plus de "choix" aux individus, est en soi "un progrès". L'utilitarisme semble, dans ce monde pourtant si agité, un consensus si l'on excepte les fanas des arrière- mondes et quelques kantiens dépassés, inaudibles. Le souci des kantiens c'est qu'ils balancent des mots censés valables tout le temps et partout... Comme "dignité". Mais ces mots ne répondent pas aux situations vivantes et n'aident pas grand monde en vérité. Ils servent surtout à justifier l'autorité.
.
Il y a peu de temps, le Conseil d'Etat français a obligé le ministère des affaires étrangères à laisser entrer un enfant né de GPA en Arménie pour y vivre avec sa "famille", c'est à dire la commanditaire. C'est la seconde jurisprudence du genre, je crois. Ceci alors que la GPA, achat d'enfants à la commande, est interdite en France. Le politique démissionne, calcule électoralement, en ne voulant pas froisser ni le catholique ni le mouvement homosexuel. Il s'en lave donc les mains. Au lieu d'affirmer une position politique, philosophique, d'élever le débat en l'assumant, il se cache derrière les jurisprudences et la mondialisation. C'est très dommageable, aussi bien pour l'Etat comme pour le politique, qui organisent leur inutilité, que pour la cohésion nationale : on ne procède pas à de telles bifurcations en douce, sans susciter des réactions insoupçonnées et des retours du refoulé dans l'inconscient collectif.
Enfin un retour d'expérience !
Le livre dont on va parler maintenant est précieux. Il offre, loin des essais pamphlétaires dont il convient de se méfier, la passion régnant autour de ces questions pour les minorités qui s'y intéressent alors que leurs représentants s'en fichent, un retour sur les premières générations qui ont eu recours à la Procréation Médicalement Assistée. Des couples de sexe différents. L'accès à la PMA leur a été permis pour impossibilité de procréer naturellement.
Les auteurs ont pu mener une recherche, influencée par la psychanalyse, mais utilisant le miroir de l'art de manière originale pour susciter la parole-, afin d'étudier ce que l'usage de la PMA pouvait receler d'enjeux psychologiques. Le résultat est riche, et ce qu'on peut déjà dire, c'est que les enjeux sont véritablement révolutionnaires en effet. Ces familles ont essuyé les plâtres d'une méthode, qui à l'époque de son autorisation a certes soulevé des débats, et été régulée, mais dont toutes les implications n'avaient certainement pas été anticipées. C'est à l'usage, et par une démarche d'enquête, d'analyse de contenu des discours de ces familles, que l'on peut aller plus loin. Et ce livre est à cet égard une avancée.
Il me semble qu'il est indispensable, mais malheureusement je vois que ce ne sera pas le cas, puisqu'on s'en remet à la jurisprudence et à la "fatalité" du village mondial, d'observer ce qu'il en est pour les familles déjà concernées, pour les enfants nés de PMA - dans le livre évoqué ces derniers ne sont pas présents, sinon dans l'analyse-. On doit aussi s'intéresser à d'autres individus dont les situations à l'égard de la filiation peuvent nous éclairer, comme les enfants nés sous X, qui clament souvent leur souffrance en vain. Ce serait la moindre des choses de s'intéresser aux humains quand on touche à l'essence de l'humain.
Pour ce "Voyage en zygotie- histoires d'embryons", Dominique Laufer et Véronique Mauron ont travaillé auprès de couples suisses. C'est important car il y a une nuance majeure. En Suisse, la loi prévoit que les zygotes congelés doivent être utilisés dans les cinq ans, ou bien ils seront détruits. Cette limitation n'est pas de mise en France, et nous verrons que ce n'est pas sans conséquence. Autre différence, en Suisse, on congèle au stade du zygote, et non comme en France au stade de l'embryon. En bioéthique, les détails sont des mondes.
Le zygote est un ovocyte imprégné par le spermatozoïde . Les deux génomes masculin et féminin sont encore juxtaposés. On les congèle.
Entre être et chose
Que sont ces zygotes pour les familles ? Voici quelques formulations : "c'est quelque chose à défaut d'être quelqu'un", "c'est une chose qui nous appartient et qui vit", "ils représentent un patrimoine commun". Dans les discours l'on décèle une oscillation entre être et chose. Et en définitive, les auteurs peuvent faire synthèse en disant qu'il s 'agit " d'êtres qu'on possède".
La PMA, par la congélation, revêt un indéniable aspect de réification.
Le zygote est une image, et un moment dans la PMA. Il suscite d'emblée une inversion : alors qu'on attend un enfant, là c'est le zygote qui attend, qu'on vienne le chercher . Chaque famille a « son petit stock » -expression d'un père-.
Le devenir des embryons surnuméraires soulève bien des soucis.
Les familles, qui essaient de trouver des références, se comparent volontiers aux adoptants. Il y a une différence un peu maudite : tous les embryons ne seront pas utilisés ou tous ne « prendront pas » de manière prévue.
Si dans l'adoption il y a « la trace » de la famille biologique, ici il y a indéniablement « la trace » du congélateur. Il y a l'exemple de cette maman qui a deux enfants, un naturel, et un issu de la PMA . Malgré sa volonté de transparence elle ne parvient pas à le dire à ses enfants. Elle ne peut pas dire à l'un, qu'il « vient du froid ». Elle a peur d'entendre : « pendant des années tu m'as laissé au froid, au congelé, tu as aimé ta fille Valérie, mais nous on était congelés ». Ce passage par la congélation laisse sa marque. Pour certains parents, il s'agit d'un passage dans les limbes, dans un endroit situé entre la vie et la mort.
La congélation suscite aussi le trouble temporel. Il est possible qu'un enfant congelé en amont de la naissance de sa fratrie, naisse après elle, quand des naissances naturelles s'intercalent. Chacun doit se débrouiller avec ces dérèglements.
Paradoxalement il est commun que la PMA engendre un doute sur la filiation et que les familles demandent, contre toute attente, des tests ADN. La technologie semble les avoir dépossédés et ils ne parviennent pas à se rassurer.
La PMA, qu'elle implique les gamètes des parents ou le recours à des dons, ce qui n'est nullement indifférent psychologiquement évidemment, dessine un nouvel arbre généalogique où la place du tiers est contestée au père. La fécondation est non plus intime mais exposée et publique. La place des médecins dans le processus est première. Il n'est pas rare qu'on donne le prénom du médecin à l'enfant né de la PMA ! Une maman a eu l'impression de tomber enceinte du médecin « créateur ». L'usage d'un vocable scientifique opaque stimule ce sentiment de dépossession.
Parmi les solutions imaginaires que les parents utilisent pour s'y retrouver il y a la métaphore du comestible. Les parents sont contents quand on évite la congélation : « Valérie a été conçue avec du frais ».
Dans l'impasse morale
Vient le moment de la question de la destruction des zygotes surnuméraires. Le dilemme est difficile. La loi impose la destruction et peut ainsi soulager le dilemme. Mais elle met en même temps une pression temporelle sur les familles. On trouve l'exemple d'un couple ou le père déclenche une dépression massive devant l'attitude de sa femme qui ne peut pas se résoudre à la destruction et veut donner leur chance aux possibles enfants congelés. Une maman déclare : « c'est clair dans ma tête, que si on n'avait pas de zygotes… Je penserais pas à un troisième ». Le désir d'enfant est donc bousculé, parfois artificiellement agité par la culpabilité de la fin de congélation.
Les cohortes familiales du droit A l'enfant sont ainsi piégées dans un devoir d'enfant.
Les familles, devant un véritable encombrement embryonnaire, peuvent ainsi être poussées à faire famille nombreuse non désirée. Quel paradoxe que les techniques de contrôle de naissance aboutissent à ce qu'elles ont voulu résoudre, comme si la nature adressait un clin d’œil retors à la science !
Et puis, il y a cette dure réalité : la PMA donne le droit de vie ou de mort. Devant ces embryons, là, qui attendent la possible chance de vivre.
Trouble dans les fratries
Ces histoires de vie vont évidemment rejaillir sur la manière d'aborder l'enfant, et sur sa personnalité. Ainsi une famille voit une enfant de la PMA comme « une bonne pâte » … Qui a pu prendre en effet, et qui prend toujours son temps – elle a été longtemps congelée. Leur autre enfant, naturellement né, est lui l'enfant vif de la famille. Les auteurs ici montrent bien qu'ils sont dans la matrice de la psychanalyse. Il n'est pas interdit de penser non plus que ce destin ait une source génétique, lié à ces différences biologiques, plutôt que de relever de la « projection » parentale.
Cette même famille est confrontée à un autre souci. L'enfant né naturellement, non prévu, supposé impossible, n'est-il pas anormal ? Ne vient-il pas bousculer ce qu'on avait entrevu ? Ne vient-il pas concurrencer les enfants congelés ?
J'ai songé, en lisant ces témoignages, à Vang Gogh, à sa biographie. A cette vie que Viviane Forrester a qualifié d' « enterrement dans les blés ». Le destin de Van Gogh a été marqué par sa substitution à un enfant mort né , un an jour pour jour avant sa naissance, qui s'appelait aussi Vincent, et dont il prenait symboliquement la place. Les conséquences psychologiques en ont été immenses. Elles ont conduit Vincent à sublimer mais aussi à souffrir toute sa vie.
On implante souvent deux embryons pour se donner le plus de chance de réussit. Cela peut aboutir à une naissance multiple, mais bien souvent on ne souhaite pas de jumeaux. Quand ce ne sont pas des jumeaux, un embryon disparaît. C'est un embryon sacrifié. Quelle est sa place symbolique ? Notamment pour l'enfant, qui lui, naîtra. Les parents organisent des cérémonies d'adieux à l'embryon disparu.
Ces difficultés parentales sont maximisées quand il y a don d'ovocytes, et que la mère peut se représenter comme simple mère porteuse, « invitée » dans la naissance.
Et puis il ya tout le processus de la PMA, qui ne ressemble pas à une grossesse naturelle. Tout est disséqué, il y a beaucoup plus d'étapes, de dangers de mort de l'enfant projeté, d'échéances hyper angoissantes. Quels sont les risques pour l'enfant, dans la transmission de cette angoisse ? C'est une question à se poser, qui demande ainsi d'enquêter cette fois-ci auprès des enfants.
La PMA suscite bien d'autres interrogations évidemment. La question de l'enfantement tardif par exemple. Mais aussi le choix de légaliser la naissance organisée d'enfants qui n'auront pas accès à leur filiation génétique. Comme dans le cas des « sous X ». Si les « sous X » sont issus d'un drame inévitable, la société a t-elle le droit de donner priorité au désir d'enfant sur la protection de l'intégrité psychique d'un enfant à naître ?
Enfin, le débat s'entrelace avec celui de la sélection génétique compte tenu des possibilités de la science. Le concept de droit à l'enfant qui s'affirme peut logiquement déboucher sur celui de droit à l'enfant que je veux. C'est déjà le cas, dans la GPA. On choisit une mère biologique. Que lui demande t-on ? Jusqu'à où peut-on aller en ce sens ? La manipulation génétique peut-elle s'en mêler ? Déjà les gynécologues, qui sont consultés par les auteurs du livre ci dessus évoqué, témoignent des demandes de PMA de convenance, évitant la sexualité. Mais on peut aussi imaginer des délégations ou reports – par congélation- de grossesse, imposés par des employeurs par exemple, ou par convenance encore. Si la loi permet, alors qu'est-ce qui pourrait empêcher l'amplification de l'audace ?
L'intérêt de ce livre est de montrer que dans le cas, qu'on pensait réglé et simple, de la PMA « thérapeutique », plus ou moins encadrée selon les pays – en France le don d'ovocytes est illégal par exemple, mais pas en Suisse-, l'impact psychologique sur les familles, et nécessairement sur les enfants, dans le recours à cette technique, est déjà considérable, complexe et multiforme. C'est au coeur de la condition humaine que l'on suscite des bouleversements.
Il est donc impensable, à mes yeux de lecteur de ce livre, que l'on règle la question de la PMA par le simple « oui » à une demande de « faire ce qu'on veut puisqu'on peut maintenant ». La PMA est trop sérieuse pour être laissé au seul désir des concernés, ni à la dynamique autonome de la science. D'autant plus que de manière réaliste, nous devons constater qu'une foi la PMA non thérapeutique légale, le principe d'égalité entre citoyens ouvrira la porte sans délai à la GPA, et à des PMA GPA de convenance.
Il ne s'agit pas d'être conservateur ni réactionnaire. Il s'agit de se demander où nous allons en tant qu'espèce. Sans nul besoin de convoquer quelque transcendance.