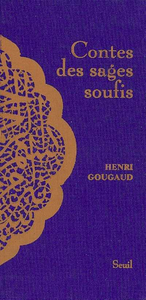Trois contes, pour terminer une vie d’écrivain.
L’Esprit Saint dans un cœur simple
Dans la première nouvelle, « un cœur simple » , Flaubert nous propose comme un contrepoint de Mme Bovary. Il réalise la prouesse de faire entrer un monde dans une petite vie, une petite chambre, de quelqu’un qui n’aspire à rien, sauf au bonheur de deux trois personnes dont elle s’occupe, et auxquelles elle donne son empathie. C’est une nouvelle à la fois fidèle au réalisme bien connu de l’auteur mais aussi avec quelques embardées presque surnaturelles, ce « cœur simple » étant, le narrateur omniscient le disant lui-même, naturellement ouvert au surnaturel (comme l’aimait Pasolini dans le peuple catholique rural).
« Les prairies étaient vides, le vent agitait la rivière ; au fond de grandes herbes s’y penchaient, comme des chevelures de cadavres flottant dans l’eau. »
Où est le réalisme de Flaubert ? Il est dans ce don de romancier, qui est celui de l’illusionniste. Le romancier sait retenir le cosmos en lui, et le redéployer. Ainsi il crée sans cesse des effets de réels, à travers des détails, des agencements, qui produisent une réalité consistante, charnelle. Cela demande une sensibilité toute particulière, qui n’est pas la même que celle du philosophe. Le détail, qui s'écarte sans en avoir l'air, c’est ce qui laisse croire que c’est vrai. Le lecteur consent à se laisser manipuler. Dans une fiction, c’est la tasse de café, le cendrier, qui vous permet de vous laisser aller à la fiction. Et Flaubert en la matière est un maître, un maître cosmologique. L’inutile n’est jamais inutile dans un roman ou une nouvelle, il est ce qui vous attache, en tant que lecteur.
On dit Flaubert ironique, il l’est, indiscutablement, et nul n’y échappe. On l’a dit nihiliste. Je ne sais pas. « Un cœur simple », qui rappelle fortement le « Une vie » de ce jeune Maupassant que Flaubert avait pris sous son aile, ne manque pas d’ironie. A l’égard des rentiers, des bourgeois inutiles, et des pauvres tout à leur servitude volontaire, de ce 19eme siècle que parcourt la vie anonyme d’une servante. Mais on est ému, malgré son pathétique, par le sort de Félicité, ce cœur simple et bon, dont on nous relate la petite vie normande de domestique, sans en faire une diablesse ni une sainte. Flaubert aurait dit « Mme Bovary c’est moi ! », mais quand il écrit cette nouvelle, il vieillit, et on peut se demander s’il ne met pas un peu de lui dans Félicité. Car finalement, après sa jeunesse, qu’a-t-il fait ? Ecrire, en Normandie. Se vouer à son œuvre et tout lui donner.
D’une psychologie sommaire de ce cœur simple, Flaubert tire une nouvelle psychologiquement dense. Elle n’a rien de « simple », cette nouvelle, elle est riche, travaillée comme à l’habitude par son auteur, comme on le sait un acharné du style. Rendant hommage par ses descriptions saisissantes à la simplicité enracinée de ces normands qu’il connaît bien. Au fond Flaubert nous appelle à ne pas simplifier les simples parmi les nôtres.
Moins l’on est exposé aux connaissances, à la circulation des gens, plus tout compte, plus tout est possiblement intense. La moindre promenade inhabituelle est une aventure. Quand Félicité se rend au port, pour dire au revoir à son neveu qui s’embarque, elle est submergée par tous ces détails qui l’entourent. On voit souvent cela dans les romans classiques, comme dans "Guerre et Paix », par exemple, où l’arrivée d’un homme dans la maison suscite les rougissements, devant trop d’émotion.
Félicité n’était rien (et donc tout au Royaume de Dieu, d’où son prénom), elle a été recueillie. Elle a fui, suite à une mésaventure avec un homme alcoolique et animé par la tentation de viol, et parvient à se faire embaucher comme domestique et nourrice de deux enfants chez une veuve, Mme Aubain, rentière sans gloire ni influence. Elle occupe un petit placard. Elle donne un sens à sa vie, en aimant les enfants de Mme Aubain. Dans cette famille qui semble perdue pour toujours sans figure du Pater Familias. Mais les enfants grandissent, et l’un des deux meurt. C’est atroce, mais cela la rapproche de Mme Aubain. Elle s’approprie la vie des gens qu’elle sert, et la lie avec sa petite vie. Le rapport d’exploitation est totalement submergé par l’absorption dans la vie familiale et les mécanismes subjectifs qui lient la servante aux Maîtres.
Félicité a un neveu qui passe de temps en temps, puis part sur la mer, et meurt lui aussi. Pour elle, les deux morts d’enfants sont liées, pas pour sa maîtresse, pour qui la souffrance n’est manifestement injuste que pour les gens de «biens », bref qui ont des biens. Félicité s’accroche alors, pathétiquement, à un perroquet, puis après l’avoir bêtement perdu, symbole de la précarité de tout, à sa version empaillée. Ce perroquet devient une sorte de totem, ou de fétiche, qui semble symboliser le lointain, ou la parole venue d’un autre monde. Cet autre monde qu’elle imagine, quand elle découvre la religion, un peu plus, en accompagnant la jeune fille de la famille Aubain au catéchisme. A Paris, pas si loin, il y a des révolutions. Mais l’impact ici est le changement de sous-préfet. Félicité imagine son neveu aux caraïbes mais ne songe nullement à Paris. Son univers mental est tissé par le peu de trajectoires personnelles qu’elle a eu à connaître. Elle sait la loi sociale, mais elle ne connaît pas l’abstraction.
Nous comprenons avec Flaubert comment le catholicisme a pu survivre au siècle de la révolution industrielle, dans ces provinces françaises isolées, lourdes, et obscures encore. L’usage de l’imparfait tout au long de la nouvelle semble faire traîner ce monde en longueur, alors que ce qui frappe en même temps est la brièveté et le manque de densité de cette vie d’un cœur simple. Son rôle consolateur était incontournable. La figure de Jésus était chaleureuse, tout simplement. Et le catholicisme a été une esthétique. Une religion sensuelle. Qui dans le délire de l’agonie, aide Félicité à mourir, suivant sa maitresse, dans l’ordre naturel, qui est l’ordre social naturalisé. Ce monde est dur, impitoyable et silencieux. Il n’est qu’attente qu’on s’en aille et qu’on revienne, peut-être. Et les vies sont des chutes, comme celle d’un révolutionnaire devenu une quasi bête, vivant avec une tumeur mortelle au bord d’une rivière. Ce monde est dur, on peut prendre un coup de fouet par un cocher, au détour d’un incident sur la route, et Félicité doit affronter un taureau pour protéger la famille Aubain, comme un rappel de la tâche toujours renouvelée de devoir faire face à la nature (un rappel du Minotaure ?).
C’est une vie de rien que celle de Félicité, appliquée à ses tâches et ne se posant nulle question, à la fois forte de ce fait et vulnérable par sa dépendance à peu de gens, auprès desquels, même par le souvenir, elle vit par procuration. Mais Flaubert la rachète, finalement, en montrant comme l’observation, la contemplation, l’attention, que le narrateur partage en partie avec « le cœur simple », qui n’a pas de grandes préoccupations, peut rendre justice à cet environnement. Une petite chambre peut être dense d’objets chargés de mémoire et de significations s’associant, créant un monde auquel on peut se rattacher, encore, malgré le néant social dans lequel on évolue. Un cœur simple n’est pas nécessairement un cœur pauvre.
Pourquoi ne pas faire de Félicité une Sainte ? Parce que sans doute, la modernité, aux yeux de Flaubert, est déjà là. Le mysticisme populaire n’est pas mort, mais la Sainteté est peut-être déjà impossible. Et le monde bourgeois ne saurait reconnaître les Saintes. Il ne voit qu’une impeccable petite Bonne, qu’on « envie », à Mme Aubain, pour ses décennies de loyauté, de discrétion et d’efficacité.
Œdipe avant Freud
La seconde nouvelle nous fait quitter le 19eme et nous conduit à l’âge médiéval. Au début de la nouvelle sur la légende de Julien l’Hospitalier, qui réinterprète un épisode de la « légende dorée » médiévale, on se retrouve chez Walter Scott, dans un moyen âge paisible et idéal. Trop paisible, même, ça finit par rouiller et s’empoussiérer, ça pourrait finir comme dans le magnifique premier chapitre du « capitaine fracasse » de Gauthier (si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup). Les châtelains ont un fils, auquel de mystérieux émissaires promettent un destin considérable. Mais les augures (nos fantasmes) diffèrent. Celle entendue par le Père parle d’un soldat, la mère a ouï parler d’un Saint. Le jeune Julien vit l’expérience de la cruauté, en tuant de petites bêtes, et son père l’initie à la grande chasse. Alors Flaubert nous convie dans ces chasses, où le jeune Julien use des oiseaux de proie. On imagine l’écrivain regardant longuement des enluminures ou gravures pour préparer ses descriptions. Julien pratique alors une hécatombe dans la faune du coin. Mais un jour, un miracle survint. Après un massacre, un cerf parla à Julien avant de mourir, lui prévoyant qu’il assassinerait ses parents. Un délire. Julien sombre dans la terreur. Et il manque, par hasard, en effet, de tuer ses parents par accident. Alors il fuit. Il devint un soldat, un de ces « routiers », qui écumaient les terres. Puis un grand soldat.
Flaubert, dense, encore, novelliste, use ici du passé simple, accélérant le rythme par rapport à la première nouvelle. Au contraire d’un cœur simple nous avons ici un cœur tourmenté, qui cherche à se perdre dans le tumulte du monde.
Pour ses services, on lui offre un « château en Espagne », et la main d’une splendide femme, dont il est passionné. Dans cet Alhambra paradisiaque, qui n’a rien de réaliste, mais de mythique, car il s’agit bien d’une légende, il s’apaise. Mais peu à peu le présage le rattrape, et il ne sait ce que ses parents sont devenus. Ils apparaissent alors, un soir, auprès de son épouse., qui les couche dans son propre lit. Pendant que Julien était retourné chasser, pour la première fois.
Il passe une nuit d’hallucination, les bêtes le chassent, et il est impuissant. Il rentre, cherche sa femme, voit un homme dans son lit, avec sa femme, et tue ses parents.
Julien devient mendiant de par le monde, comptant sa légende. Il est délivré de toute destinée. Il essaie d’aider les autres. Un jour il parvint près d’un fleuve, et se dédie à aider les autres à traverser. Puis il est visité par un lépreux, qui lui demande de tout lui donner, et Julien accepte. Même de se blottir contre lui pour le réchauffer. Alors Julien monte au ciel, et se retrouve face à Jésus Christ. C’est le motif d’un vitrail en Normandie qui inspire Flaubert.
On songe à Œdipe évidemment. La même fatalité, et le même mobile.
De quoi est chargé le destin de Julien ? A y réfléchir, la clé est peut-être au début de l’histoire. Les fantasmes parentaux s’opposent, et ne communiquent pas (chacun en garde le secret). Julien est sans doute écartelé entre deux désirs, et jamais le sien n’existe. Il est préempté, deux fois, par deux parents différents. Il se retournera contre eux, tuant leur désir, finalement. Et en même temps, Julien aura été le soldat grandiose, puis le Saint, il aura accompli le désir d’autres. De ses parents. De tuer tous les animaux n’aura servi à rien pour conjurer le conflit intérieur de Julien.
L’art pour l’art dans l’évangile
Le troisième moment est antique, au moment où prêche Jésus. Il est cité dans deux évangiles. Peu auront rendu l’époque si vivante. Seule Yourcenar surpasse sans doute Flaubert (avec un saut de trois siècles). Une fois encore, c’est sans doute moins le fond de l’affaire qui intéresse Flaubert que la cosmologie qu’il peut en tirer, et les sensations qui l’accompagnent. Là où les textes religieux sont édifiants, le texte flaubertien est charnel. Il y a là une sorte d’impiété, très banale aujourd’hui, où l’on voit fleurir des romans et des films réinterprétant, en offrant un regard, des parties des textes sacrés. Comme Boulgakov, Caillois ou Emmanuel-Schmidt écrivant sur Pilate. Mais à l’époque de Flaubert, ce n’était pas commun. Et il y a trente ans on organisait un attentat intégriste dans une salle projetant "La dernière tentation du Christ" de Scorcèse. Finalement, que dit Flaubert sans le dire ? Que se sont des histoires comme les autres. Que ce qui compte est la manière dont on les raconte. Il n’y a rien d’édifiant à y trouver. Et personne ne saurait en inférer la foi ou l’impiété de l’auteur.
Hérode Antipas, roitelet, est perché au-dessus du lac de Tibériade et il voit les troupes arabes se venger de sa répudiation de la fille de leur roi, au profit d’Hérodias ; romaine. Un mariage scandaleux, car il la substitue à son demi-frère. Mais la passion du début, même s’il s’agissait d’un mariage très politique, n’est plus là. Ils se méfient l’un de l’autre, et tentent de s’amadouer. Les romains sont là, alliés ambigus, méprisants, menaçants, à travers le proconsul de Syrie Vittelius, qui inspecte carrément les biens du Roi soumis à Rome. Il y a là, au fond d’un trou, un prophète dangereux aussi, emprisonné, dont on ne sait que faire, qui promet la dévastation puis le Royaume. Nous y reconnaissons Jean-Baptiste. Il menace Herodias. Comme un révolutionnaire.
« Le seigneur arrachera, tes pendants d'oreilles, tes robes de pourpre, tes voiles de lin, les anneaux de tes bras, les bagues de tes pieds, et les petits croissants d'or qui tremblent sur ton front, tes miroirs d'argent, tes éventails en plumes d'autruche, les patins de nacre qui haussent ta taille, l'orgueil de tes diamants, les senteurs de tes cheveux, la peinture de tes ongles, tous les artifices de ta mollesse ; et les cailloux manqueront pour lapider l'adultère ». Hérode essaie de le « refiler » aux romains dans un premier temps, comme on le fera pour Jésus.
On banquète pour l’anniversaire d’Hérodias. Et les différentes sectes juives sont représentées, et d’autres, venus de l’Est. Tout le conte est secoué par un désordre constant, une sorte de chaos de fond, qui exprime parfaitement cette époque-là, d’échauffement spirituel intense, de bouillonnement politique aussi, en Palestine. Un Jacob parle de Jésus, le Prophète, qui commet des miracles, ce qui laisse l’assemblée sceptique, mais au final, craintive. Le prophète emprisonné, ici, serait Elie, l’annonciateur. Salomé, fille d’Hérodias, est rentrée pour l’occasion. C’est une danseuse lascive, enchanteresse, elle tourne la tête d’Hérode, et réclame celle de Jean Baptiste sur un plateau, et Antipas lui donne. Mais le décapité avait dit « pour qu’il croisse, il faut que je m’amoindrisse ». Salomé, figure de séduction et de cruauté, permet ainsi à Jésus de s’affirmer comme le Messie. La légende dira que Salomé mourra en sombrant sous un lac de glace, la tête sortant de l’eau, comme posée sur un plateau. Hérode, lui, sera finalement exilé à St Bertrand de Comminges, à une heure au sud de Toulouse.
Et voici que se terminent trois contes écrits peu de temps avant la disparition de Flaubert, comme un dernier écho à Madame Bovary avec Félicité, à Saint Antoine avec Julien, à Salammbô avec Salomé. Une Trinité. De la nouvelle purement fictive, on est passé à la réinterprétation du mythe, puis à un épisode des évangiles impliquant des êtres historiquement réels. Le cœur simple voyant le Saint Esprit dans un Perroquet. Julien rencontrant Jésus. Et Jean Baptiste annonçant le Royaume de Dieu. Et ça et là, des bourgeois, c'est à dire des gens qui "pensent bassement" comme Gustave le dit ailleurs, de la patronne de Félicité au père de Julien, jusqu'à Hérode le comploteur.