"François s’accrochait pour sauver sa vie. Pas étonnant qu’il fût terrifié de mourir ! De fait, combien de temps peut-on se cramponner ? Chaque tension résulte de la façon dont nous nous cramponnons à notre « chère vie ». Littéralement, peu importe les muscles qui entrent en jeu. Chaque tension fait partie d’un schème total, qui constitue la structure caractérielle, et est prévu pour assurer la survie de l’individu. S’écarter de son caractère est une expérience effrayante. L’individu la ressent comme une perte d’identité, un non-être momentané, la mort (...) Quelque temps plus tard, lors d’une autre séance de thérapie, Michel rapporta que les tensions de son cou et de ses épaules devenaient intolérables. « Si je laisse retomber ma tête, ou si je la baisse, je me sens faible, désarmé, effrayé. Je dois me redresser. » L’arrière du cou, particulièrement à son point de jonction avec le crâne est l’un des points les plus importants de tension, de contrôle du corps. Rares sont ceux qui ne souffrent pas de fortes tensions dans cette zone. Nous avons tous peur de laisser retomber notre tête, car la baisser c’est perdre contrôle. « Ne va pas perdre la tête », conseil que l’on entend souvent. Avoir contrôle signifie que le corps est soumis à la volonté du Moi et qu’il n’y aura aucun mouvement sans le consentement du Moi. La volonté est aux commandes. Dans le cas de Michel il s’agissait de la volonté de vivre. Pour lui, laisser retomber sa tête signifiait l’effondrement, la défaite, la mort. "
Alexander Lowen
.
Alexander Lowen est l'épigone (et l'ancien patient du psychiatre freudo marxiste Whilhem Reich, après son départ aux Etats-Unis. Il est aussi plus "clinique" que Reich, en tout cas dans ses publications, Reich étant surtout connu pour "Ecoute petit homme" par exemple, et son travail sur la personnalité fasciste-autoritaire. La vie de Reich (elle vaut le coup d'être lue) est un roman qui finit dans une confusion dont on ne sait si elle a frôlé le génie ou sombré dans la folie. On sent chez Lowen quelqu'un de plus terre à terre et prudent. Cependant je ne savais pas qu'il était aussi proche des intuitions de Reich même si je savais qu'il s'en inspirait.
Reich s'est séparé de Freud quand le vieux maître est devenu pessimiste, et qu'il a pensé devoir admettre que dans la psyché se manifestait une autre pulsion que l'Eros. Jusqu'à un certain point, Freud a pensé que le souci c'était la répression de l'Eros par l'éducation réactionnaire. Puis il s'est résolu à considérer une pulsion autonome (Thanatos), qu'il lie (selon ce que j'en comprends de mes lectures de Freud et d'autres) à la pulsion de vie d'ailleurs. Eros et Thanatos dansent la valse. La vie est une tension qui aspire à la détente, au nirvana (l'extinction), donc à la mort. D'où l'appétence pour la mort. Cette pulsion de mort est contrebalancée par l'Eros, et par le surmoi (le travail de civilisation),, mais le contingentement est fragile. Les freudo marxistes, en l'espèce un peu rousseauistes, n'ont pas accepté ce virage pessimiste de Freud, dans "Au delà du principe de plaisir" puis "Le malaise dans la civilisation". Ils ont continué à creuser l'idée selon laquelle la répression était la cause des soucis psychiques. Je ne sais pas qui a raison. Il est clair qu'en regardant l'Histoire, un peu comme le fait Schopenhauer (le seul philosophe que freud disait aimer), on a du mal à donner tort à Freud. Pour autant la tradition reichienne peut sans doute pêcher par rousseauisme mélancolique qui ne cède pas, mais elle apporte aussi des idées originales. Et notamment sur la question du corps. C'est notamment la création du concept de "cuirasse" sur lequel on reviendra.
L'essai "La peur de vivre" (première parution en 1981) est clair et passionnant, dépourvu de jargon, et nombre de "névrosés" s'y reconnaîtront dans les portraits de patients qu'il réalise. Je dis cela, parce qu'il est évident que lorsqu'on se sent mal, savoir que d'autres sentent la même chose, et souvent s'en sont sortis, ne peut qu'aider. A cet égard, la lecture de "La peur de vivre" est déjà une source d'espoir potentielle qu'on ne peut conseiller qu'à "nos amis un peu nerveux" comme les qualifiaient Freud, dédramatisant, mais aussi, mine de rien, insinuant que le névrosé se différencie du quidam qui "va bien" de très peu. Ajoutons que le quidam qui va bien peut être un psychopathe. Pour ma part, je suis convaincu du fait que pour accéder à un certain niveau de pouvoir il faut être un Sage, comme Marc-Aurèle - vous m'en montrerez, hein. Nelson Mandela par exemple. Ca ne court pas les rues - ou plus ou moins psychopathe, c'est-à dire dépourvu de sensibilité à l'égard d'autrui. En tout cas en notre monde. Les névrosés, eux, ne sont pas taillés pour le pouvoir. Ils ont d'immenses qualités de sensibilité, donc de nuance, de psychologie, d'analyse, d'imaginaire, mais le pouvoir, ce n'est pas pour eux. Il me semble.
L'originalité de Lowen c'est d'abord sa définition simple de la névrose, comme une peur de la vie. La peur conduit à la volonté de contrôler. Et voilà le piège. Ce piège est d'autant plus répandu dans une société où la réussite individuelle est la norme à atteindre et donc où le contrôle est essentiel. D'où la pandémie dépressive contemporaine. En quelques mots, déjà, on comprend beaucoup.
La névrose vient du conflit intérieur on le sait. Un conflit non résolu. L'originalité de Lowen après Reich est de définir ce conflit comme opposant le Moi et le corps. Pourquoi ? Simplement parce que la raison essaie de contrôler les sentiments, et que les sentiments, c'est le corps. Cette lutte épuise le Sujet. Quand le Moi et le corps sont trop en tension, comme un archer qui tire trop sur la corde de son arc, ça craque.
A partir de là vient l'intuition à Reich, puis à Lowen, que l'attitude physique offre une fenêtre très claire sur le conflit intérieur du Sujet. Le psychiatre "bioénergétique" regardera donc d'abord par exemple comment vous vous tenez sur le sol.
"Nous sommes notre corps, notre corps révèle ce que nous sommes".
Nous sommes doubles. Il y a l'animal en nous. Et il y a l'être conscient, qui a tendance à se prendre pour Dieu et à vouloir tout contrôler, y compris la mort de l'animal. Mais c'est impossible. La peur de la vie, c'est donc bien entendu la peur de la mort, en dernière instance.
Alors qu'on dit au névrosé "bats toi", le problème est justement qu'il se bat ! Il lui faut apprendre à cesser de se battre. Et ce n'est pas joué.
Lowen n'est pas du tout Deleuzien. Il reprend totalement la conception de l'oedipe bâtie par le Maître viennois. La névrose tire sa source de ce moment important de l'enfance où il faut réprimer son désir à l'égard du parent de sexe opposé. Le complexe d'Oedipe est surmonté par le biais de l'angoisse de castration.
Nous érigeons donc des défenses contre nous-même, et contre les menaces de la vie. Et le problème du névrosé est assez simple à comprendre. Il s'enferme dans le château de ses défenses. Se sentant enfermé, il réagit en renforçant encore ses défenses. Ces défenses forment, chez Reich et Lowen une "cuirasse corporelle". Le névrosé est un chevalier incapable de sortir de son armure. Certains reconnaîtront sans doute cette cuirasse qu'ils ressentent sans cesse sur leurs épaules, épuisant leur nuque, leue jambes.
Que peut-on faire ? On peut essayer de supprimer les émotions. Mais c'est peine perdue. Cela s'appelle le refoulement. Les émotions sont toujours là.
La thérapie a alors our objectif de restaurer la capacité à vivre ses émotions. Ce que le patient contrecarre, évidemment, par des réflexes de résistance, ce qu'il a mis en place, et qui ne disparaît pas aisément. La clé sera donc de parvenir à cesser de se battre contre soi-même.
Chacun de nous a ainsi un "caractère", un type d'armure. Le psychiatre bioénergétique va donc procéder différemment du freudien. Il va d'abord essayer de "lire le corps", tout en ne renonçant pas, loin s'en faut, à la recherche de la vérité qui est au coeur de la démarche psychanaytique.
Sur le plan thérapeutique, il s'agira d'aider le patient à retrouver accès à ses émotions, par des techniques corporelles diverses, adaptées à sa singularité.
La cuirasse et renforcée, c'est l'aspect marxiste, par une société qui oblige à jouer un rôle, et à renoncer à Etre, tout simplement. Un enfant, est. C'est pourquoi il a tant d'énergie. Plus tard nous nous épuisons à jouer des rôles, et certains types de sociétés sont très exigeants en la matière. Lowen ne le dit pas, mais on pense à la notion de "savoir être". C'est une invention post moderne dont on mesure mal la portée. Il faut donc savoir être... Alors que l'Etre est précisément ce qui ne devrait pas se discuter. Si l'on remonte la pression autant en amont, cela ne peut qu'avoir de lourdes conséquences. Nos corps savent pourtant décharger la pression, par exemple par les pleurs, un procédé très efficace. Mais comme le chante Robert Smith, "Boys don't cry".
Il s'agit donc de lâcher le Je pour retrouver le Soi. Nous arrivons ainsi au carrefour des sagesses, qui disent toute la même chose. Le yoga, la méditation, la sophrologie, tous ces courants aboutissent à la même Rome.
Le Soi c'est d'abord le corps. L'oubli du corps (mal manger par exemple) est le destin du névrosé. Cela peut prendre beaucoup de formes, mais les reichiens insistent sur la sexualité. Attention, on peut avoir une grosse activité sexuelle, et ne pas vivre sa sexualité pleinement parce que l'on n'a pas accès à son Soi.
Lowe, effectue une belle distinction entre Etre et Faire. La volonté fait, la sensation est. Le névrosé est enfermé dans le faire.
"On ne peut faire ou produire de sensations pas plus que l’on peut faire être."
. On ne ressent pas "afin de", "pour". Si l'on entre dans ce mécanisme, on est fichu. On entre par exemple dans l'obsession de la performance sexuelle, parce qu'on veut avoir des sensations, pour se sentir mieux. On fait, donc.
"Cependant si nous faisons autant attention au processus qu’au but, faire devient une action créative, une expression du soi et accroît le sens d’être. En ce qui concerne le mode être, ce qui compte n’est pas ce que l’on fait, mais comment on le fait. L’inverse s’applique aussi bien au faire. Lorsqu’une activité vient d’elle-même, elle relève de l’être, lorsqu’elle est forcée, elle relève du faire. (...) nous pouvons dire que pour certaines personnes le travail est un jeu parce qu’il est agréable (il « coule »), alors que pour d’autres le jeu est travail parce qu’il leur est une expérience pénible.".
On ne peut sans doute pas apprendre à Etre, mais on peut certainement, en thérapie, apprendre à "ne pas faire". Par exemple respirer profondément sans faire.
Etre c'est évidemment Etre au présent, Faire c'est déjà être dans l'avenir, c'est ne jamais coïncider avec l'Etre.
Relâcher le contrôle est très difficile, car cela engage la peur de la folie. ". Nous n’osons pas remettre en cause les valeurs selon lesquelles nous vivons ou contre lesquelles nous nous rebellons à l’égard des rôles que nous jouons, par crainte de mettre en cause notre santé mentale."Le patient a peur de la dissolution du Moi. C'est pourquoi la relation entre thérapeute et patient doit s'établir, et se traduire par un transfert, afin que les expériences de lâcher prise puissent se réaliser, lâcher les tensions, et permettre une renaissance à son Soi.
"Être pleinement vivant c’est abandonner son être au gré d’un flux de sensations"
Le thérapeute doit prendre garde de ne pas abattre les défenses trop vite. Mais il reste que la peur de l'effondrement provient d'un effondrement qui a déjà eu lieu. On ferme la porte, par le contrôle, sur une salle qui a déjà été violée. Le Sujet a ainsi surmonté comme il le pouvait ce choc psychique, par la volonté, et cela a construit la cuirasse contre le corps.
La voie de la thérapie est ainsi de retrouver la capacité à ressentir les émotions sans sombrer dans la dissolution du moi, ni en les saccageant.
Rejoignant bien des courants asiatiques, Lowen considère que le ventre est le centre du Soi. C'est donc là que se joue la renaissance possible.
Il est paradoxal, dans un livre, de dire que la connaissance ne suffit pas, et que s'en remettre entièrement à elle est dangereux. Mais c'est ainsi. Foncer dans la connaissance mutile.
"Compter sur la connaissance et le pouvoir présente un inconvénient, à savoir que la première est incomplète et le second trop limité. Seul Dieu est omniscient et omnipotent ; c’est une illusion de notre part de croire que nous pouvons devenir des dieux."








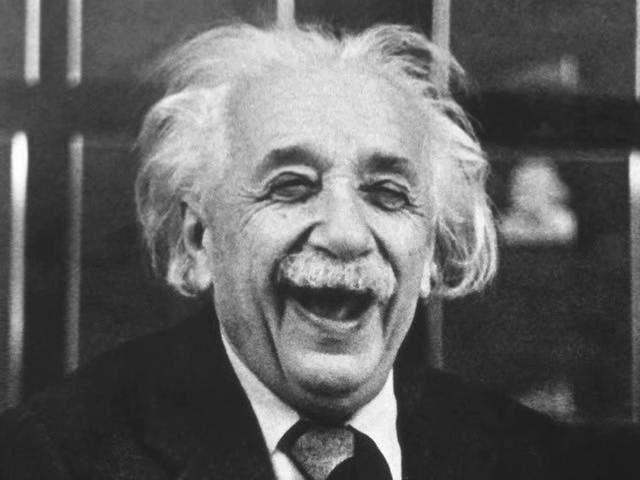

/image%2F0991408%2F20140718%2Fob_5cbdc0_agora-smart-girls-film-club-1.jpg)
/image%2F0991408%2F20140718%2Fob_d0f60c_agora-smart-girls-film-club-1.jpg)
 "
"

