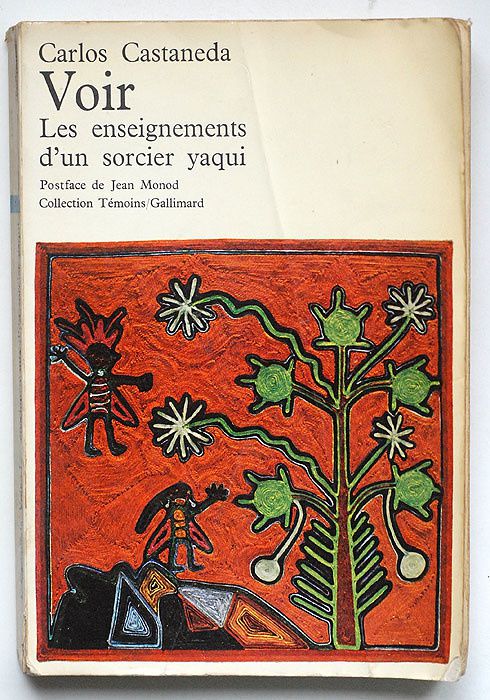Quel superbe livre, d'une conception si inhabituelle. La narratrice connaît un immense chagrin d'amour. Elle est quittée par l'amant, un homme connu, qui préfère finalement sa famille et sa femme. Elle vit une tragédie véritable. Et dans ce moment, elle entend, dans ses propres tourments, dans les phrases de ses amis qui la consolent, l'écho des vieilles lectures de Racine. Elle est Bérénice, et l'homme qui la quitte est Titus. Qui peut-être ne l'aima pas vraiment. Mais cela, finalement, seul Titus l'a su. En tout cas Nathalie Azoulai titre son livre "Titus n'aimait pas Bérénice".
Alors la femme quittée, qui doit survivre, et pour cela s'obséder et s'oublier, ou du moins resituer sa souffrance dans la longue chaîne interminable et incontournable du chagrin humain, pour tenter de la banaliser, ou au contraire de l'anoblir, va reprendre Racine (j'ai conscience du caractère lacanien de mon expression en l'écrivant). Pour certains, constater que leur souffrance est partagée, qu'elle est partie intégrante de la condition humaine, fatale d'une certaine manière, a des vertus curatives, ou au moins "consolantes" (l'adjectif prisé par l'auteur-e). Pour d'autres, au contraire regarder le malheur du monde n'ajoute qu'à leur fardeau. Il y en a, parmi nous, pour lesquels les grands mots des génies confèrent une dignité à leur souffrance, en la reconnaissant. Pour d'autres, au contraire, le fait qu'on puisse si bien décrire leur souffrance, sans la guérir, n'est qu'une irritation de plus.
Elle va plonger dans ses drames, dans sa vie, et la raconter dans ce livre, avec une capacité à percer l'intimité, ou à l'imaginer, d'une haute valeur littéraire. Racine y perd de son statuaire mais pas de sa grandeur. Il redevient un génie parmi nous, avec ses petitesses, et surtout ses propres souffrances, et personnellement je ne l'en admire que plus encore après cette lecture (j'en étais resté à l'arriviste qui trahit Molière). Nathalie Azoulai, dans cet exercice, impressionne. Notamment dans la manière dont elle montre la progression de Racine, la dynamique de son apprentissage, les seuils déclencheurs possibles. Elle n'est pas agrégée de lettres pour rien et la pédagogue parle dans la romancière.
Elle imagine comme un génie peut se nourrir et apprendre, consolider par l'exercice, lier les connaissances, passer dans de nouvelles dimensions. C'est tout à fait admirable et même "bluffant" pour tout dire. Comme lecteur aimant à écrire, j'imagine l'effort d'imprégnation qu'un tel livre suppose, car il a fallu que Mme Azoulai devienne intime de Racine, en tout cas d'un Racine supputé, qu'elle déchiffre la cohérence d'un "Moi" sur toute une vie, et l'on sait que ce n'est pas chose aisée pour Soi-Même. Tout cela narré dans un style très pur, assez pur pour respecter, sans caricature, le siècle et l'ambiance intellectuelle où se niche son sujet, sans vouloir refaire Grand Siècle. En ramenant donc Racine à hauteur du présent et en nous rapprochant de lui. Double mouvement.
Pourquoi Racine ? Parce qu'il donne au malheur d'amour toute sa dimension. Parce qu'il écrit le tragique, juché sur les épaules des grands Anciens, Homère ou Sophocle, mais en français, et à partir d'un enseignement en Français, à l'Abbaye de Port-Royal. Son rapport au bastion janséniste est d'ailleurs un des intérêts les plus cruciaux du livre, nous le verrons. Comme la narratrice, qui ressemble beaucoup à l'auteur-e, le français compte. Son ambition pour la langue s'inscrit dans sa langue maternelle. Racine a beaucoup traduit, enfant, beaucoup constaté, aussi, l'utopie de la traduction. La Vérité ne s'approche sans doute que par le chemin de la langue maternelle. Très tôt, ses Maitres lui ont appris à prendre au sérieux cette langue.
Quand nous souffrons, nous pensons, nous pensons avec des mots. Ces mots renvoient à d'autres mots, à des syntaxes, parfois inconscientes, mais aussi partagées avec d'autres, qui ont lu les mêmes mots que nous. Ces mots nous font souffrir parce que nous sommes conscients et que le langage est le fil de fer du langage, qui égratigne notre santé, mais ils constituent aussi, peut-être, en même temps, un fin grillage entre la douleur et Soi.
Racine, cet enfant de bourgeois, est vite identifié comme un élève exceptionnel à Port-Royal. Prometteur mais déjà attiré par ces domaines impies qui occuperont plus tard ses drames. La narratrice suppose que c'est Didon, la Reine quittée par Enée chez Virgile, qui l'y aura attiré. Il plonge en tout cas dans l'ambition démesurée et infinie de vouloir toucher la vérité par le langage. Elle le poursuivra toute sa vie, et quand il arrêtera les tragédies, pour écrire les chroniques militaires du Roi Soleil, il sentira, selon l'hypothèse du livre, un sentiment d'imperfection face à un Vauban qui lui, maîtrise la matière, bâtit des forteresses indiscutables, alors que toujours son œuvre sera reconnue mais discutée par les envieux qui laissent traîner le doute, ou bien les anciens Maîtres, qui couvrent la conscience de Jean de leur ombre culpabilisante. On ne saurait écrire un texte qui inspire le silence complet de l'approbation, et mette fin à tous les textes. Comme tous les génies de la langue, Racine est conduit dans cette impasse. Mais le virus est très tôt attrapé et irrémédiable : la langue. Connaître toutes les possibilités de la langue, quitte à aller contre les lois déjà édictées.
Nous allons donc, parce que la Bérénice contemporaine doit s'oublier, retrouver ou plutôt trouver un Racine dépoussiéré. L'ambition métaphysique devient ambition sociale chez le jeune homme. Il faut aller à Paris et trahir le jansénisme sans jamais vouloir le trahir. Aller à Paris, marcher sur Corneille ou sur Molière, pour devenir le plus grand poète de son temps. Ecrire, voir ses mots reconnus, les entendre dans leur harmonie, dits par les plus grands comédiens, c'est être dans le Siècle. Ce qui suppose d'aller au bal parisien, et d'y danser. Heureusement d'y connaître, aussi, des amis fidèles, comme La Fontaine, et surtout Boileau.
Mais en ces temps, si l'on quitte l'ombre de Dieu dans le vallon de Port Royal, ce n'est que pour tomber sous le jugement de son lieutenant, le jeune Roi Soleil, qui a le même âge que Racine. C'est lui qui juge, permet qu'on soit édité, joué, mis en avant, protégé. On dit souvent que le Roi préférait la comédie, mais Molière n'est pas éternel. Et le Roi, qui a fait de la culture un fondement central de son pouvoir, et de la monarchie elle-même, en finissant avec les frondes, a besoin de la gravité d'un Racine, aussi. Lui, qui déteste Port Royal, ne parviendra jamais à conduire son tragédien le plus grand au reniement de ses attaches, et Racine en sera quelquefois un peu puni, à la marge. Ce n'est que dix ans après la disparition de Racine que Louis fera détruire Port Royal.
Finalement, de l'austérité des chambres de Port-Royal aux triomphes des tragédies dans les jardins de Versailles, c'est la même quête qui serpente. Se soumettre à Dieu, obtenir la reconnaissance symbolique et matérielle, toujours nuancée, toujours en suspens, toujours précaire, du Roi, c'est le même désir fondamental d'Infini. La même aspiration à "tout, absolument tout" pourrait-on dire, qui justifie une existence. La même chimère, qui se déplace.
La même chimère, que l'on vit dans l'amour ? C'est ce que laissent penser les amours de Racine pour deux actrices. La première, qui mourra prématurément, la seconde, qu'il quittera après le sommet de Phèdre, parce qu'il ne pourra pas aller plus loin. Mais il les aura aimées passionnément, en confondant son amour avec sa passion pour la langue, dont elles devaient, et voulaient, être le vecteur. S'il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas de quête heureuse de l'Infini. Mais cette quête vous tient debout, tout de même. Malgré ses tourments d'hyper sensible comme on le dit aujourd'hui, Racine trouvera la force de continuer, de paraître devant le Roi, de vivre enfin. Comme Bérénice, la post moderne, trouve la force de continuer, dans l'amour de la littérature, qui le pressent-on, donne un sens à sa vie.
Que le sort de Racine ressemble à celui de Lully, sous cette même emprise royale. A celui de Molière aussi, mais qui semblait plus sage lui, plus préoccupé aussi, des siens, de son entreprise qui le dépassait, plus pragmatique. En ces temps où être un grand artiste supposait se soumettre tout en rêvant d'être indispensable au souverain, espérer beaucoup mais aussi courber la nuque, Racine aura connu le plus beau et le plus désespérant. Mme Maintenon l'aura obligé à écrire pour ses petites élèves, en faisant mine d'adhérer. Il devra servir de chroniqueur aux guerres du Roi. Celui-ci essaiera, et seule la mort sauvera Racine, dans sa période dévote tardive, de faire renier Bérénice au tragédien, pour des raisons d'évolution politique. Mais quelle incompréhension ! Quelle déception, que ce souverain aimé qui ne peut comprendre, alors, de quoi il s'agit, alors que pourtant il a donné tant de signes de vraie complicité. Louis n'avait pas de génie particulier dit Norbert Elias, mais il avait celui de dominer et de rendre dépendant non seulement objectivement, ce qui n'était pas difficile, mais aussi subjectivement. Ah, un mot du Roi ! C'est un signe de Dieu. Pour ceux de Port-Royal le Roi n'était pas Dieu, et le Roi le savait très bien. Il n'aurait jamais pu leur pardonner cela.
Racine fut toujours clivé, non pas comme le Titus d'aujourd'hui, entre Maîtresse et épouse, mais entre l'esprit de Port-Royal et son succès à Paris et à la Cour. Il devait tout à ses Maîtres austères, et le climat du vallon participe de son talent (même Louis le comprend, lui qui est toujours si politique et ne donne jamais tout à fait raison aux camps qui se haïssent et dont il est le point d'équilibre indispensable : la noirceur de Racine tire sa source de son éducation). Racine imposera, malgré la mode des machines scéniques, des mises en scène arides très jansénistes. Et puis il y a cette autre vie parisienne d'adulte qui le mena jusque dans l'intimité du Roi, l'enrichit, lui assure le titre du poète le plus grand du Royaume, Directeur de l'Académie après la mort de Corneille.
Pour réussir cette vie il dut connaître la chair, le pêché, car on ne peut pas écrire sans savoir un peu de ce que l'on parle (sinon on est, pour reprendre une provocation d'Emmanuel Todd dans un registre qui n'a rien à voir, "un puceau de la pensée"), et ceci Racine le comprend très tôt, quand il ne connaît que peu de paysages, peu de manières de parler, un petite partie de la palette des sentiments. Ce n'est pas dans la réclusion janséniste qu'on peut devenir le plus grand poète, seulement le meilleur traducteur, peut-être, et lui veut créer. Pour créer il faut vivre. Des exemples montrent le contraire, comme la vie de Kant. Mais les grandes faiblesses (à mon sens) de la philosophie kantienne, ne sont-ils pas aussi le reflet, de ce que Nietzsche appelait "la santé des philosophes" ?