 Toute la politique économique de l'Europe se fonde sur
cette idée que l'économie, ce sont des lois indiscutables issues des manuels libéraux. Il n'y a qu'à les respecter et puis taisez-vous donc. Il y aurait la raison à l'oeuvre chez les
élites dirigeantes, toute alternative relevant de la déraison ou autres tares : "démago", irresponsable, et surtout.... "populiste" : la tarte à la crème, nullement utilisé par hasard,
puisque ce mot révèle toute la vraie crainte, plus encore le vrai dégoût de ceux qui l'utilisent ad nauseam : le peuple. Cette masse incontrôlable et qui ramène sa fraise, a le droit de
vote, etc...
Toute la politique économique de l'Europe se fonde sur
cette idée que l'économie, ce sont des lois indiscutables issues des manuels libéraux. Il n'y a qu'à les respecter et puis taisez-vous donc. Il y aurait la raison à l'oeuvre chez les
élites dirigeantes, toute alternative relevant de la déraison ou autres tares : "démago", irresponsable, et surtout.... "populiste" : la tarte à la crème, nullement utilisé par hasard,
puisque ce mot révèle toute la vraie crainte, plus encore le vrai dégoût de ceux qui l'utilisent ad nauseam : le peuple. Cette masse incontrôlable et qui ramène sa fraise, a le droit de
vote, etc...
Foutaise évidemment que cette idée d'un cercle de la raison. L'économie n'est qu'une énième penderie de la philosophie et de la lutte entre les intérêts
constitués dans la société pour contrôler la rareté et le pouvoir. Si elle est scientifique, c'est évidemment de manière circonstanciée et partielle. Jamais sur un plan général et
prédictif.
Ceci est tellement vrai que lorsque les théories économiques sont ridiculisées par les faits, comme depuis la crise financière de 2008 puis la crise de
l'Euro, on ne change pas de théorie dans les élites dirigeantes et les économistes en tort ne font que conforter leurs présupposés. On s'adapte parfois, empiriquement, mais on ne touche
pas à la théorie. On sépare la pratique de la théorie pour ne pas discréditer cette dernière, intouchable.
Même l'Eglise, au bout d'un moment, a quand même été obligée de reconnaître que la terre était ronde (bien qu'elle n'ait réhabilité Galilée qu'à la fin du
XX eme siècle). Mais les économistes et policitiens libéraux, monétaristes, hayekiens, tout ce que l'on veut pour les qualifier, n'en sont pas encore à cette capacité de révision montrée par les
ecclésiastiques.
C'est contre cette logique, d'abord, que semblent écrire Michel Aglietta (dont nous avons récemment évoqué un
très bon livre sur l'économie chinoise) et Thomas Brand dans leur récent essai sur la crise de l'Euro : "Un new deal pour l'Europe". Un essai un peu pointu parfois mais très clair, sérieux mais pas jargonnant pour le
principe.
Y a t-il encore un but possible à la construction européenne ? On est en droit de se le demander au regard de la situation vécue qui tourne les
peuples les uns contre les autres et fait apparaître tout cet édifice comme un jeu de dupes. Si on ne saisit pas la gravité de la période très vite on peut penser que nous sommes
promis à une époque sombre, digne du dépecace de l'Empire de Charlemagne.
Mais il est en même temps frappant de constater que pour s'en sortir, nous bénéficions de nombreuses contributions de grande qualité qui convergent très
largement. Les économistes, quand ils ne sont pas complètement drogués aux différents opiums du néolibéralisme, analysent de manière convaincante ce qui se passe depuis 2008 et proposent des
solutions. Malgré les divergences, le consensus se dessine sur beaucoup d'éléments. Il existe donc une voie de sortie. Ce qui peut étonner, c'est que tout cela s'exprime, mais
reste ignoré de nos gouvernants. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la raison qui conduit le monde, encore moins les idées. Ce sont d'autres considérations liées à la puissance.
Considérations qui peuvent mener le monde à sa perte.
Il est temps de regarder en face une réalité : la naissance de l'Union économique et monétaire a été le fruit d'un compromis destiné à ancrer l'Allemagne en
Europe au moment où l'Est s'ouvrait. Et ce compromis a considérablement affaibli la France et l'Europe du sud. Triste réalité.
En accouchant de l'UEM, on n'a pas voulu voir ce qu'était une monnaie. Parce que c'était la condition incontournable pour les allemands que de
respecter leur vision très particulière de la monnaie, qui ne pouvait pourtant se concevoir au plan européen dans les conditions tracées.
Un édifice miné de l'intérieur
Donc, tout l'édifice était miné. Quand on apprend l'économie, dès les premières leçons on nous parle du fameux "triangle d'incompatibilité" que rappellent
les auteurs. On ne peut pas à la fois avoir une monnaie unique, la liberté de circulation des capitaux, et une liberté nationale de politique économique. On doit renoncer au moins à l'un des
trois. Or, l'Europe n'a pas unifié sa politique économique. Ca ne pouvait pas fonctionner, et ça un jeune étudiant l'aurait su. C'est le drame de la politique que d'être capable de nier
l'évidence, mais ce sont les peuples qui en paient le prix.
Dans l'Allemagne d'après-guerre, fondée sur un consensus "ordo libéral", la monnaie a une place première. Elle est antérieure à la
réunification. Elle est un élément fondateur du contrat social. L'Allemagne est un pays dont il faut mesurer l'Histoire. Issue de petits Etats et de petites villes où la petite bourgeoisie
artisanale et commerçante avait une grande place. Portant des valeurs de travail, d'épargne, d'efficacité. Une petite bourgeoisie très conservatrice, fermée. Le nationalisme allemand a su
réactiver certaines de ces tendances, aujourd'hui portées par la CDU, héritière du Zentrum.
Après guerre, ces valeurs petites bourgeoises se sont matérialisées dans le système de cogestion, qui rappelle les corporations d'antan. Dans l'ordo
libéralisme, il y a un lien entre politique et économie. Un ordre global et stable. Les valeurs de la classe moyenne allemande ont été codifiées pour assurer la stabilité, avec le souvenir du
chaos. La constitution est aussi économique et sa base est la monnaie. Elle est le ciment national, la base, le lien de confiance. Le mot "fiduciaire" prend tout son sens dans la culture
allemande. La grande crise du mark qui déboucha sur la victoire de Hitler est évidemment le traumatisme initial. Etrangement les auteurs éludent cet épisode, il me semble au contraire,
pour reprendre une expression de Freud, constituer la scène primitive...
Les auteurs ne citent pas Emmanuel Todd, mais il n'aurait rien à redire sans doute au sérieux qu'ils prennent à saisir la spécificité culturelle de l'Allemagne.
En Allemagne ne sont légitimes que les intérêts économiques ne remettant pas en cause la stabilité des prix. La banque centrale encadre ainsi toute la politique économique, et
les négociations entre capital et travail autour de la répartition.
La réunification allemande, cet évènement énorme qu'on ignore souvent en France, a suscité des besoins immenses de financement public. Ainsi la banque
allemande a réagi par une politique monétaire "féroce" contingentant les risques d'inflation. L'Allemagne a alors vu son économie flancher et les emplois ont fondu. Les taux
d'intérêt allemands en hausse ont déclenché une vague spéculative sur l'Europe, et des effets économiques déjà graves. Le Serpent Monétaire Européen avait explosé. Un avertissement
ignoré. Les auteurs ne citent pas l'expression de Philippe Seguin, dont on n'avait pas pris toute la mesure au delà de l'aspect métaphorique : "munich social"...
Cet épisode n'a fait que conforter l'idée de basculer dans l'euro, censée protéger de la spéculation (on voit que ce n'est pas le cas), et surtout censé
faire converger les économies européennes. C'est le contraire qui s'est déroulé, l'Euro ayant été, et c'est le point le plus important
du livre, un facteur de morcellement, et de spécialisation des pays. Paul Krugman a reçu le prix nobel pour avoir montré que l'unicité d'une monnaie intensifie les échanges internes et
augmente la spécialisation industrielle des territoires. Délestée des risques de change, l'industrie va là ou elle dispose des meilleures conditions. Les technologies de l'information, au lieu
(ce que l'on a pensé) de contrer cela ont au contraire facilité le processus de concentration.
En Europe, se sont dessinées une Europe allemande conçentrant l'industrie et une Europe du sud en désindustralisation. Bref l'unification a suscité une
réorganisation de la production sur un continent non uni politiquement et économiquement.... La grande contradiction est née.
Ce qui est assez sidérant, c'est que depuis le rapport Werner dans les années 70, qui proposa le premier projet de monnaie unique, on savait ce qu'il
convenait de mettre en place pour accompagner le processus, et notamment une politique budgétaire commune et une harmonisation fiscale. Mais le triomphe des ides reagano thatchériennes
influençant les élites européennes, et aussi françaises (les socialistes français au pouvoir dans les 80's), l'idée que la monnaie devait être neutralisée s'est imposée. On a accepté l'idée
allemande d'une monnaie gérée par une banque indépendante, seulement tournée vers la lutte contre l'inflation. Et déconnectée de toute stratégie économique publique d'ensemble.
Au lieu de sortir par le haut de ces contradictions, on réagit par des règles de discipline de plus en plus drastiques censées aligner les pays sur
l'Allemagne, avec les critères de maastricht puis le pacte de stabilité d'Amsterdam, puis la règle d'or. Des erreurs qui se cumulent. Il faut voir ce que ce pacte d'amsterdam avait
d'absurde et de purement philosophique pour les allemands : il proposait de sanctionner les pays faisant du déficit.... en creusant leurs déficits par des sanctions.... On est plus dans la morale
petite bourgeoise venue du moyen âge que dans la "responsabilité". D'ailleurs ces sanctions ne seront jamais appliquées.
Cet euro déséquilibré naît au moment où les marchés libérés par les gouvernements de toutes entraves déferlent, et produisent tout un tas
d'innovations spéculatives. On les laisse faire, puisque selon la théorie libérale dominante, ils sont censés allouer les ressources de manière optimale. Tout cela se réalise dans une euphorie
dont on doit mesurer le caractère ridicule aujourd'hui : à Lisbonne en 2000, l'UE prétend qu'elle sera en 2010 l'économie la plus dynamique et compétitive du monde... Les seules choses
qui croitront, ce sont les bulles spéculatives et le chômage....
La prise de pouvoir d'une finance insatiable
Puis la crise des subprimes frappe le monde. La course à l'endettement en est une source, et on peut noter qu'à aucun moment la fameuse "discipline de marché" n'y a
mis un frein, au contraire. L'idée de l'autorégulation des marchés est morte, et pourtant elle guide encore le monde... Le gonflement monstrueux de la sphère financière s'est focalisé en Europe
sur l'Irlande et le Luxembourg, deux paradis fiscaux en plein coeur. De ces bases sont partis des logiques spéculatives vers l'Espagne, le Portugal, la Grèce....
Cette course à l'endettement, contrairement à ce que nous assènent les éditorialistes télévisés, est d'abord privée. C'est un dérèglement de la
finance et non une impéritie de gestion des budgets publics. Les gouvernements ont laissé faire la spéculation, mais ce ne sont pas les dettes publiques qui provoquent la crise. Ce n'est
qu'après, lorsqu'il faut juguler la crise, que les dettes publiques bondissent, en 2009.
Les bulles spéculatives ne sont limitées par rien. Elles ne sont le produit que de "supputations", elles sont donc par nature illimitées.
La finance n'a aucune base réelle, elle n'est que la conséquence de ce principe capitaliste de faire de l'argent avec de l'argent, qui n'a pas de frontière, c'est un désir qui "ne rencontre
aucune satiété". Les marchés financiers ne sont pas comme les autres, les prix n'y sont bornés par aucune considération autre que le désir d'argent, le vocabulaire de ces marchés est
psychologique : confiance, optimisme, aversion... La logique est haussière, car l'on s'endette pour faire de l'argent. Les marchés sont des monstres déchaînés. Les besoins de financement
d'une économie ne sont viables que s'ils sont subordonnés au politique. Telle devrait être la grande leçon de la crise mondiale et de celle de l'Euro. On ne la tire pas. Au contraire, on
s'enferre dans "la pire erreur de diagnostic" à savoir que le problème viendrait des dettes publiques.
La situation à laquelle on doit aujourd'hui répondre est celle d'une Europe spécialisée, où le bloc allemand a accumulé des excédents extérieurs, le sud des
déficits. Les logiques de spécialisation ont été amplifiées par le cavalier seul de l'Allemagne qui a pratiquée seule dans son coin une baisse du coût du travail sous direction du SPD et
des Verts, et en même temps une politique industrielle conforme à sa tradition : l'intégration verticale efficace de son industrie, qui dessine une complémentarité entre des
activités délocalisées sur les pays de l'Est et les PME allemandes.
L'entrée de la Chine à l'OMC est venue amplifier ces déséquilibres en accentuant la pression mondiale.
Pendant ce temps, alors que l'Allemagne s'organisait industiellement, la France s'anglosaxonisait, confiant la propriété des entreprises aux fonds
étrangers, qui ne voient en elles que des actifs délocalisables et non des outils de production à transmettre à la génération suivante.
Globalement, l'Europe a perdu des millions d'emplois industriels, mais c'est le Royaume Uni, la France, le Sud, qui ont dévissé. Les dépenses de recherche et
développement et les brevets se concentrent aujourd'hui en Suède et en Allemagne, la France est décrochée.
Persévérer dans l'erreur, s'enfoncer dans l'impasse
Les effets du choc de 2008 n'ont pas été surmontés. Les capacités de production dans l'ensemble du monde occidental n'ont pas rattrapé leur niveau d'avant
crise. L'Europe a répondu surtout par la baisse des taux d'intérêt de la BCE (encore cette semaine). La production a chuté rapidement dans les premiers mois comme dans les années 30 et
puis on a évité le pire en empêchant les faillites bancaires. L'existence de la protection sociale et des politiques budgétaires - les fameux stabilisateurs automatiques-ont été
déterminants.
Mais les gouvernements ont tès vite rechuté dans leurs tendances libérales : pas d'assainissement bancaire, pas d'accord sur le défaut de paiement de la
Grêce, et retour très vite à l'austérite budgétaire : "la consolidation" comme on dit avec euphémisme.
La situation de la Grêce a été très mal gérée selon les auteurs. On a perdu de vue une idée simple : un Etat n'est pas un particulier. Il
lève des impôts mais surtout sa durée de vie est infinie. Or, l'horizon des marchés est très retréci. Ils sont obsédés par la revente des titres (la liquidité) et ils la confondent avec la
solvabilité d'un Etat qui est une question de très long terme. Les agences de notation ont joué un rôle autoréalisateur pervers, et la crise grecque a rejalli sur tout
le sud européen. Une réponse aurait pu être la transparence des bilans bancaires pour éviter la panique. L'Europe a perdu son temps en plans de sauvetage qui ont transféré des pertes privées en
dettes publiques, un véritable impôt POUR la fortune...
L'austérité budgétaire n'a jamais été aussi inutile qu'en ce moment, puisque la relance par le budget est d'autant plus efficace quans les
agents se désendettent et que les taux sont bas. Pourtant l'Europe a organisé une chute de l'investissement public et dilapidé tout l'effet sur la croissance qui en aurait
résulté.
On ne peut plus continue sur ce chemin car sinon on va vers des catastrophes économiques et politiques. A chaque sommet européen, on ne fait que
suivre l'avis du plus gros créancier qui éponge les plans de sauvetage, l'Allemagne. Il est temps de donner un coup de volant très net.
Cela passe par le changement du rôle de la BCE, la réalisation d'une union bancaire, d'une union budgétaire, et par la mutualisation des
dettes publiques. Il s'agit de transformer l'euro en véritable monnaie. Sinon la zone euro éclatera. Et avec elle le projet européen.
Rompre avec la politique économique menée
Doit triompher l'idée (que plus aucun dirigeant européen ne défend !) que la monnaie n'est pas une marchandise. Elle est un outil du
contrat social. Elle est liée à la dette publique, qui est un contrat de la société avec le futur. Un lien entre les générations. L'Etat et la banque centrale sont indissociables.
Il en résulte une leçon qui est une rupture : l'Etat doit "toujours avoir la possibilité de mettre sa dette hors marché, de la
monétiser", bref de la faire financer par la banque centrale, ce qui est aujourd'hui le tabou européen, et d'abord en Allemagne. Les auteurs restent sur un terrain économique, mais
on peut voir en ce tabou non seulement une peur panique de l'inflation, historiquement ancrée, mais aussi une défense du rentier retraité allemand. Le vieillissement européen, tel est un obstacle
à une politique de croissance qui bénéficierait à l'emploi.... des jeunes actifs.
Le budget européen est en baisse.... Dramatique contresens, car la spécialisation des territoires doit s'accompagner nécessairement d'une
politique budgétaire unifiée, comme cela a été tranché aux Etats Unis après la guerre d'indépendance. Si les américains avaient été aussi bornés que nos leaders européens d'aujourd'hui,
leur pays serait une sorte de "mosaïque" impuissante. Qui dit budget européen dit impôt européen, et mutualisation des dettes par exemple par des eurobonds. Cette unification pousse à
l'harmonisation fiscale, qui doit redonner de la puissance à la demande, et à une "répression coordonnée" de l'évasion fiscale. L'investissement décisif dans les pays en
difficulté doit être financé, y compris par une taxe sur les transactions financières.
L'Allemagne va devoir sortir de cette vision de son invulnérabilité dans une Europe où la croissance s'effondre. Et elle doit comprendre
qu'il est absurde de transformer toute l'Europe en Allemagne.... Car c'est simplement impossible.... Pour qu'un pays exporte il faut des importateurs... La concurrence entre Etats
européens sur les coûts, c'est à dire une logique de dévaluation interne, ne mène qu'à l'appauvrissement général.
Pour les auteurs, il est temps de mener la grande explication idéologique. Le monétarisme s'est effondré. La banque centrale centrée
sur l'inflation n'a pas évité les bulles immobilières. On a la preuve que stabilité des prix et stabilité financière ne sont pas synonymes. L'efficience des marchés dans la répartition des
ressources est un mythe nocif. Les banques centrales doivent disposer d'un éventail d'outils, et pas que du taux directeur, sinon elles ne peuvent pas agir comme l'a montré la crise. L'isolement
du monétaire et du budgétaire n'est pas possible, il faut les utiliser ensemble : politiquement.
L'union bancaire doit permettre de séparer le trading de l'investissement et du dépôt. On doit unifier en Europe les mécanismes de garantie des
comptes (jusqu'à 100 000 euros disent les auteurs qui ont écrit avant la crise chypriote), et faire financer le fonds d'assurance par
les banques. Au passage, ils soulignent que le sauvetage européen des banques, qui a été général, sans distinction, a été un scandale. En sauvant de la faillite les joueurs de casino on a
piétiné un principe de l'économie de marché, à savoir le risque... Et donc on incite, à l'intérieur de ce système, à l'irresponsabilité des acteurs. La logique du "trop gros pour mourir"
l'a emporté, montrant que les Etats étaient pris en otage par l'oligopole bancaire. Il faut renverser le rapport de forces. Ceux qui contrôlent les banques doivent absorber les pertes.
L'adoption de la fameuse règle d'or de l'équilibre budgétaire est absurde, non seulement dans le contexte, mais généralement. C'est comme si
on interdisait à une entreprise d'emprunter pour investir. Or il est anormal de penser que l'on va faire payer par les seuls contribuables d'aujourd'hui des investissements qui dureront
des décennies. Les déficits et la dette sont nécessaires et même vitaux.
L'histoire montre que revenir à des déficits plus modérés devrait s'étaler sur deux décennies. Roosevelt avait essayé d'écourter la phase de relance
après la grande dépression et avait du se raviser. On doit envisager des plans quinquennaux. La réussite dépend avant tout d'un taux de croissance supérieur durablement aux taux d'intérêt
réels.
On doit complètement réenvisager dans ce contexte la notion de compétivité. Comme le montre justement l'Allemagne, elle est liée à
l'innovation, à l'apprentissage organisationnel dans les entreprises, à la qualité des relations au travail qui booste la productivité. La compétitivité d'une nation n'est pas celle,
micro économique, d'une entreprise soumise à des concurrents sur un même marché de produits. L'austérité budgétaire est inefficace, mais aussi celle sur les salaires, car il est clair que la
rigueur salariale pèse à la baisse sur la productivité, et "mange" donc les baisses de salaires. La vision libérale de la compétitivité ne peut pas fonctionner en Europe.
Sortir de la stagnation est possible
La question se pose d'un nouveau cycle de croissance qui puisse porter l'emploi. Et c'est l'innovation qui sera le déclencheur. Les auteurs
pensent comme beaucoup que le front décisif sera le développement durable. Ils rappellent que d'ailleurs, toutes les révolutions industrielles (machine à vapeur, pétrole, fée
électricité) ont été liées à la nécessité de trouver un nouveau modèle énergétique. Nous y sommes : l'accumulation de capital se heurte à la rareté des ressources naturelles.
C'est un changement révolutionnaire qui s'impose, jusque dans la comptabilité qui doit intégrer le coût du changement
climatique. Il est temps de définir une valeur sociale du carbone et de l'intégrer dans les coûts. Sous la forme de taxes. Et par exemple une taxe aux frontières de
l'Europe.
Mais il est certain que les marchés court termistes ne mobiliseront pas les immenses investissements nécessaires pour transformer nos modes de vie et de
production. Pour mener ces transformations, l'intervention publique doit prendre la direction, par exemple pour restructurer totalement l'industrie automobile condamnée si on continue à
ignorer la réalité. Agir en ce sens suppose en préalable de rompre avec la politique du droit de la concurrence qui prévaut au niveau européen et qui empêche toute politique
industrielle.
On voit que les remèdes proposés par les auteurs sont puissants, et rejoignent bien d'autres contributions. Tout le monde sait peu ou prou que c'est dans
cette direction qu'il convient d'agir, les désaccords étant assez secondaires (on pourrait débattre du protectionnisme par exemple, encore que le livre évoque une taxe carbone aux
frontières).
Et pourtant... tous ces travaux ne sont pas portés politiquement par quelque dirigeant européen, sinon sous la forme de formules verbales. Pourquoi
? Les auteurs en restent à l'idée de la rigidité théorique... Car ils sont des économistes et ne s'aventurent pas sur le champ politique.
La réalité est que se pose évidemment la question de la stratégie et des moyens pour aboutir en cette clairière. Il y a toujours deux moyens possibles : la
coalition de forces imposant une nouvelle ligne, ou l'action d'un acteur primordial qui va essayer de déclencher une rupture et d'entraîner ainsi d'autres forces.
La coalition existait théoriquement à la fin des années 90 pour faire prévaloir une autre ligne que le libéralisme en Europe. Or, ce fut tout le
contraire. C'est justement à ce moment que l'on a voté le pacte de stabilité, déréglementé la finance... Donc ces forces ont perdu leur crédibilité et sont désavouées par les suffrages.
Et elles n'ont d'ailleurs pas réfléchi sérieusement à cette époque, se louant encore de leur attitude....
Donc il reste la possibilité de l'action d'une puissance autour de la table. La France, grande perdante de cette histoire, pays où l'action de
l'Etat a encore un sens pour les citoyens, puissance moyenne mais décisive au plan européen par son économie encore importante, sa population jeune, et bientôt la première de la zone, est sans
doute la mieux placée.
Qu'attend t-elle alors ? Manifestement que la situation, par miracle se résolve toute seule. Par on ne sait quel phénomène surgi des mystères des fonctionnements
des sociétés, ou par intelligence de l'Allemagne capable d'aller spontanément contre toute sa tradition. Et cette attente est dépeinte en réalisme. Or, le caractère précieux d'un ouvrage
comme ce "new deal pour l'Europe", c'est justement de prouver que le réalisme c'est l'audace presque inouie de tout remettre en cause.
Sans l'intervention directe des peuples européens, on a du mal à imaginer que nos dirigeants dignes, polis et conformistes se décident à bousculer des décennies
d'orthodoxie, dont ils ne reconnaissent même pas les nuisances.







/image%2F0991408%2F20150319%2Fob_a01a22_thca3o4dba.jpg)
/image%2F0991408%2F20150319%2Fob_29f3e8_thca3o4dba.jpg)
/image%2F0991408%2F20141231%2Fob_8dbb76_thca32j9ke-jpg)
/image%2F0991408%2F20141231%2Fob_449f8d_thca32j9ke-jpg)
/image%2F0991408%2F20140709%2Fob_c5ac04_piketty.jpg)
/image%2F0991408%2F20140709%2Fob_5d719c_piketty.jpg)
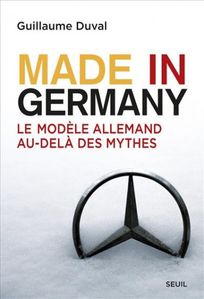 L
L T
T E
E T
T